Le grand entretien avec André Grimaldi

JUIN 2020
Quelles leçons tirer de la crise du coronavirus ?
Que faut-il attendre du Ségur de la santé ?
Quels seraient les grands axes d’une réforme de notre système de santé ?
Entretien avec André Grimaldi, Professeur émérite, CHU Pitié-Salpêtrière.
« Après l’incendie,
repoussent des roses ou des ronces »
Dans le livre que vous avez codirigé, Santé : urgence*, paru en mai, vous écrivez que les périodes de crise sont propices aux grandes réformes dans la santé. Nous y sommes…
Effectivement, notre système de santé a réalisé des bonds en avant lors de crises : 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, création de la sécurité sociale ; 1958, guerre d’Algérie, fin de la quatrième République, création des CHU ; 1968, contestation sociale et grève générale, augmentation importante
du nombre des professionnels de santé suivie, en 1970, par la reconnaissance législative du service public hospitalier puis, en 1971, par la première convention entre la sécurité sociale et les syndicats de médecins libéraux. En sera-t-il de même de l’après-Covid ? On peut l’espérer mais il ne faut pas oublier qu’après un incendie, sur la terre brûlée, peuvent repousser des roses mais aussi des ronces.
Vous insistez dans votre ouvrage sur l’insuffisante prise en charge des maladies chroniques. Quel état des lieux dressez-vous et quelles sont vos propositions ?
Pour des raisons historiques, nous avons construit un système de soins plus qu’un système de santé.
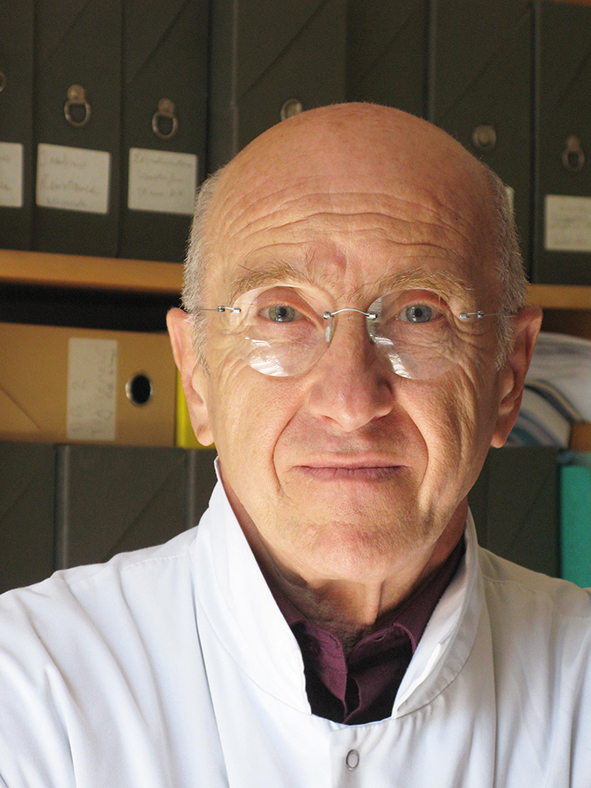
Nous sommes bons pour la mortalité évitable grâce aux soins, et nous sommes très mauvais en matière de prévention et d’inégalités territoriales et sociales de santé. Finalement, nous avons construit notre système autour, d’une part, des maladies aiguës bénignes et des gestes techniques simples pris en charge en ville et, d’autre part, des maladies aiguës graves ne passant pas par les urgences, et des gestes techniques complexes pour l’hôpital et la clinique.
Le paiement à l’acte en ville et la tarification à l’activité à l’hôpital sont adaptés à ces activités. Mais notre système est inadapté aux maladies chroniques dont la prise en charge biomédicale et psychosociale varie d’un patient à l’autre, évolue dans le temps, nécessite une éducation thérapeutique du patient et un accompagnement personnalisé, et pose la question majeure de l’observance.
C’est en réalité une autre médecine (la « troisième médecine »), qui implique une coordination entre les professionnels et qui doit être réalisée en équipe pluriprofessionnelle. Ni le paiement à l’acte, ni la T2A ne sont adaptés. Cela va faire 15 ans que nous le répétons en vain.
Mais ce que nous avons découvert plus récemment, et que la pandémie Covid a confirmé, c’est que notre système est également inadapté aux urgences et, a fortiori, aux épidémies qui nécessitent, elles aussi, une coordination structurée entre la ville et l’hôpital, un travail en équipe et un financement au moins en partie par dotation ou « forfait populationnel ». Il est en effet indispensable d’avoir en permanence des lits vides pour l’accueil des urgences si on veut éviter le scandale des heures passées sur un brancard dans l’attente d’un lit. Il faut adapter le mode de financement et d’organisation à l’activité, et non l’inverse.
Nous avons utilisé successivement le prix de journée, de 1945 à 1983, la dotation globale, de 1983 à 2004, et le paiement à l’activité, de 2004 à aujourd’hui. Le moment est venu de les utiliser simultanément en comprenant que l’hôpital n’est pas une entreprise commerciale qui vend des séjours comme une grande surface vend ses produits, et que le modèle de la chirurgie ambulatoire standardisée et programmée ne peut pas être transposé aux autres activités.
L’odontologie ne souffre-t-elle pas des mêmes maux ? Les pathologies de la cavité buccale ne mériteraient-elles pas d’être assimilées à des maladies chroniques ?
Effectivement, nombre de pathologies de la cavité buccale sont des pathologies chroniques, nécessitant prévention et éducation pour l’adoption de nouveaux comportements d’auto-soins.
De plus, les pathologies chroniques liées à l’âge, aux maladies métaboliques, aux maladies mentales, etc., sont souvent associées ou intriquées, avec en plus la survenue possible d’effets secondaires délétères des traitements.
Beaucoup de chirurgiens-dentistes plaident pour la création d’un statut d’assistant(e) dentaire de niveau 2…
Parmi les nouveaux métiers de la santé, le besoin de professionnels paramédicaux spécialisés et expérimentés (dits de « pratique avancée ») semble le plus impérieux. Travaillant en coordination avec les médecins, ils pourraient réaliser un certain nombre d’actes et assurer le suivi d’un certain nombre de patients, y compris pour le renouvellement des prescriptions.
Ces professionnels devraient bénéficier de formations dans les facultés de médecine transformées en facultés de santé et bénéficier d’une revalorisation salariale significative. En attendant, il faudrait reconnaître les acquis de formation professionnelle et valider les acquis de l’expérience.
Il y a toujours eu des craintes de la part des praticiens de ville de se voir « fonctionnarisés ». Que nous montre l’histoire ?
Effectivement, depuis la création, par la Révolution, des officiers de santé en 1793, les médecins ont peur d’être « fonctionnarisés ». Ils luttèrent pendant un siècle pour leur suppression, actée en 1892 et, depuis, à chaque fois qu’un gouvernement proposait une délégation de tâches médicales aux paramédicaux, on entendait : « revoilà les officiers de santé ». D’où notre retard dans la reconnaissance de métiers d’infirmiers dits de pratiques avancées. La peur de la « fonctionnarisation » explique aussi l’opposition historique des syndicats de la médecine libérale à la gratuité des soins et à la sécurité sociale et, plus récemment, au tiers payant. La première convention avec la sécurité sociale n’a été signée qu’en 1971.
En fait, la sécurité sociale à la française était une réponse originale récusant l’étatisation à l’anglaise et la régulation par le marché des assurances privées à l’américaine. Elle faisait de la santé un « bien commun » ayant des recettes dédiées, un bien ni privatisable ni étatisable et géré par les parties prenantes, initialement les syndicats, puis les partenaires sociaux.
Mais elle avait quatre défauts. Premier défaut, les ressources étaient liées au travail, et l’accès aux prestations n’était pas universel. Deuxième défaut, elle n’était pas cogérée avec les professionnels qui y étaient hostiles. Troisième défaut, elle n’était pas contrainte à l’équilibre des comptes entre les recettes et les dépenses. Quatrième défaut, pour rallier la mutualité nationale initialement hostile, elle lui concéda la gestion d’un « ticket modérateur » qui n’a jamais rien modéré.
En conséquence, l’augmentation des dépenses a entraîné plus d’étatisation et plus de privatisation.
Depuis 2004, le directeur de la Cnam est nommé par le gouvernement et, depuis 2018, les recettes de la Sécu ne sont plus sanctuarisées ; en 2019, le gouvernement y a puisé 2,5 milliards d’euros. Le remboursement des soins courants est de plus en plus délégué aux assurances privées complémentaires, dont les primes augmentent.
Finalement, notre système de santé a des coûts de gestion très élevés avec 7,5 Md pour les assurances complémentaires qui ne remboursent que 13 % des coûts des soins, et 7,3 Md pour la Sécu qui en rembourse 78 %. Le remboursement des dépassements d’honoraires par les mutuelles permet de ne pas revaloriser les tarifs du secteur 1 remboursés par la sécurité sociale.
Progressivement, cela sape la base de la solidarité, les assurés appartenantaux classes moyennes ayant le sentiment de payer deux fois : une fois la Sécu pour la solidarité et une deuxième fois leur assurance privée complémentaire, de plus en plus onéreuse, pour payer leurs soins courants. Il faudrait remettre tout cela à plat et revenir à l’esprit des fondateurs de la Sécu avec une assurance maladie obligatoire, « bien commun » ayant des recettes sanctuarisées et cogéré par les professionnels, les représentants des usagers et l’État finançant à 100 % un panier de prévention de soin solidaire. Il n’y aurait plus d’assurances complémentaires mais seulement des assurances supplémentaires.
Le secteur 1 remboursé devrait être revalorisé pour créer un vrai service public de la santé, au service du public, indépendant des industriels de la santé et ayant une autonomie par rapport à l’État, avec pour règle éthique s’imposant aux professionnels comme aux usagers : le juste soin pour le patient au moindre coût pour la collectivité.
Cela suppose de mettre en place avec les professionnels une vraie politique d’évaluation de la pertinence et de la qualité des soins.
Cela suppose aussi qu’un certain nombre de frais d’équipement, de secrétariat et d’assurance professionnelle soient pris en charge par l’assurance maladie.
Avez-vous quelques bonnes raisons de penser que l’après-Covid-19 sera différent de l’avant ?
Les paroles du président de la République sur une santé devant échapper aux lois du marché, sur la gratuité des soins « une chance et pas une charge », sur le jour d’après qui ne sera pas un retour au jour d’avant, avaient soulevé l’espoir d’un changement de cap. On espérait à la fois moins de logique commerciale et moins de bureaucratie, la fin de l’hôpital-entreprise vendant des séjours, la complémentarité à la place de la concurrence pour répondre à des besoins et non pour chercher à gagner des parts de marché…
Nous étions optimistes jusqu’à la lecture du document officiel convoquant le Ségur de la santé où ne figure pas une fois le mot « public » – ni hôpital public, ni service public hospitalier –, et jusqu’au discours du Premier ministre lors de l’inauguration du Ségur. Pas question de changer de cap, il s’agit seulement d’accélérer…
Faudra-t-il attendre la deuxième vague ou la prochaine pandémie pour qu’enfin les gouvernants comprennent que la santé est un bien commun ni privatisable ni étatisable ? Professionnels et usagers devraient s’unir pour les y aider et, en tout cas, pour imposer que la santé soit au cœur du futur débat présidentiel (voir le programme des Jours heureux sur le site des éditions Odile Jacob).
Propos recueillis par Marc Roché,
président de la SOP
↪️ retour au sommaire des grands entretiens





