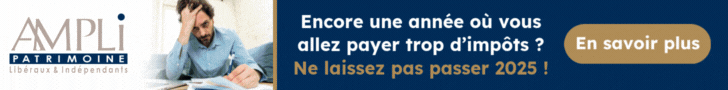Le grand entretien avec André Comte-Sponville

JANVIER 2017
Le grand entretien avec André Comte-Sponville, philosophe et écrivain.
Dernier ouvrage : « C’est chose tendre que la vie », édition Albin Michel, 2015.
« Dieu est mort : vive la sécu !
Marx est mort : vive les psychotropes ! »
Vous avez donné une conférence dans le cadre du S3Odéon, association médicale qui relie science santé et société. En quoi ces trois domaines seraient-ils indissociables pour la médecine et, par extension, la médecine bucco-dentaire ?
Ils sont en effet indissociables, puisque la préservation ou la restauration de notre santé sont une dimension essentielle de notre vie, donc aussi de notre société, et dépendent de plus en plus des progrès scientifiques.
Ces progrès sont évidemment une excellente chose, mais ne sauraient tenir lieu de politique de la santé.
La question du financement est ici décisive. Tant que les dépenses de santé sont financées en partie par la dette publique, cela veut dire que ce sont nos enfants qui paieront les soins dont nous bénéficions. Ce n’est ni moralement ni politiquement satisfaisant.
Le domaine de la santé est désigné par certains comme porteur pour le secteur de l’industrie. Mais quid des start-up adossées au numérique ?
Je ne suis guère compétent sur le sujet. Les start-up doivent bien sûr jouer leur rôle. Mais les grands groupes pharmaceutiques aussi. Le vrai problème me paraît ailleurs. Les industries de la santé créent de la richesse, et c’est tant mieux. Mais la santé est aussi une dépense.
Vous connaissez la formule fameuse et juste : « La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût. » Comment est-ce possible, dès lors que le prix mesure le coût ? La solution du paradoxe tient dans le constat suivant : la santé qui n’a pas de prix, pour moi, c’est la mienne et celle de mes proches ; celle qui a un coût, c’est la vôtre et celle de n’importe qui. Cela pose à nouveau le problème du financement.
Autre formule bien connue : « Le client est roi ». Dès lors que le patient n’est pas un client (ce n’est pas lui qui paie, ou pas totalement), il ne saurait être roi.
Dans une démocratie, le seul « roi », c’est-à-dire le seul souverain, c’est le peuple. C’est donc à lui de décider de la part de la richesse nationale qu’il veut consacrer aux dépenses de santé, en essayant de trouver le système le moins injuste possible. C’est pourquoi on a créé la sécurité sociale. C’est lourd, c’est compliqué, ça coûte cher, et il faudra sans doute la réformer. Mais la réformer pour la sauver, car c’est aussi un des plus fantastiques progrès sociaux de toute l’histoire de l’humanité.

On prédisait voilà 30 ans que l’hygiène et la prévention éradiqueraient la carie. Mais aujourd’hui, notre profession a recours à des moyens techniques de plus en plus lourds, puissants et onéreux pour corriger, réparer, restaurer, reconstruire. Comment en est-on arrivé là ?
Vous êtes mieux placé que moi pour répondre à la question ! Je n’ai jamais cru que la prévention pouvait suffire à tout. Le progrès doit s’appuyer à la fois sur la prévention – il me semble que l’hygiène buccale a fait de grands progrès depuis 50 ans – et sur la réparation. Mais en comprenant aussi qu’on ne peut pas garantir à tous une dentition parfaite. Contrairement à ce que certains croient, il n’y a pas de droit à la santé. Car on n’a droit qu’au possible, ce que la santé n’est pas toujours.
Nul n’a droit à la santé. On a droit aux soins, ce qui est très différent, et dans la mesure seulement où les moyens de financement sont disponibles. Cela nous renvoie à la question précédente, sur la sécurité sociale et la maîtrise des coûts.
L’innovation couvre un champ large qui va des aides au patient, comme la brosse à dents connectée, à celle du praticien avec l’empreinte optique ou la CFAO.
Cette aide va-t-elle dans le sens de l’intérêt du premier et du second ? N’allons-nous pas vivre de nouvelles aliénations ?
Là encore, vous êtes mieux placé que moi pour répondre. La brosse à dents électrique me paraît un vrai progrès, dont je m’étonne que les dentistes ne le popularisent pas davantage. La brosse à dents connectée, je n’en sais rien. Tout progrès technique est bon (puisque c’est un progrès) ; mais cela ne prouve pas qu’on doive toujours l’utiliser. Quant au risque d’aliénation, c’est à chacun de s’en préserver. Si vous avez besoin d’Internet pour vous brosser les dents, je crois qu’il faut en effet vous inquiéter…
Vous critiquez sévèrement la définition que l’OMS donne de la santé (1).
Le dentiste et les systèmes sociaux doivent-ils aussi satisfaire toutes les demandes des patients ?
La jeunesse, les dents blanches « comme à la télé », etc. ?
Cette définition de l’OMS est absurde. Si la santé était un « état complet de bien-être physique, mental et social », cela voudrait dire que toute angoisse, tout chagrin, tout souci seraient pathologiques, ce qui est bien sûr idiot. Imaginons que votre femme vous annonce qu’elle a un amant. Il est vraisemblable que votre bien-être ne sera plus complet.
Mais cesserez-vous pour cela d’être en bonne santé ? C’est possible, par exemple si vous faites une dépression, mais ce n’est nullement certain ! Et les quatre millions de chômeurs de notre pays ? Leur bien-être social n’est sans doute pas complet. Mais faut-il les envoyer tous chez le médecin ?
Pour combattre le chômage et améliorer le sort des chômeurs, je compte davantage sur l’économie et la politique que sur la médecine ! J’ai 64 ans. Sincèrement, si, depuis ma naissance, j’ai eu trois jours de « complet bien-être physique, mental et social », c’est un strict maximum !
Est-ce à dire que je n’ai vécu que trois jours de santé ? Bien sûr que non ! Bref, l’OMS confond la santé et le bonheur, ou plutôt la santé et l’idée fausse que l’on se fait du bonheur, lequel n’est pas non plus « un état de complet bien-être » (je m’en suis expliqué dans de nombreux livres, y compris le dernier : “ C’est chose tendre que la vie “ ).
« L’OMS confond la santé et l’idée fausse que l’on se fait du bonheur »
Le Primum non nocere est-il encore d’actualité ?
Oui, bien sûr. Mais il est de moins en moins suffisant. Plus la médecine progresse, plus l’attente vis-à-vis d’elle augmente. On demande de plus en plus à la médecine, parce qu’elle peut de plus en plus. Mais le risque est alors de trop lui demander, y compris de lui demander l’impossible : ne plus souffrir, ne plus vieillir, ne plus mourir…
Bref, j’ai le sentiment que nous sommes en train d’assister à une médicalisation de l’ensemble de notre vie, voire de l’ensemble de notre société. Je crains que nous ne soyons en train de dériver –moins d’ailleurs du fait des médecins que d’une demande sociale qui est très forte – vers ce que j’appellerai un pan-médicalisme, c’est-à-dire une culture, une civilisation de plus en plus dominée par le seul idéal de la santé, et donc soumise à la seule efficience de la médecine.
La première occurrence que je connaisse de cette idéologie pan-médicale, c’est une boutade de Voltaire : « J’ai décidé d’être heureux, parce que c’est bon pour la santé ». Le jour où le bonheur devient un moyen par rapport au but suprême que serait la santé, se produit une inversion complète par rapport à ce que l’on pensait depuis au moins vingt-cinq siècles, à savoir que le bonheur était le but, dont la santé était l’un des moyens, certes particulièrement précieux, mais qui ne saurait être une fin ultime. Une occurrence plus récente de ce pan-médicalisme : un dessin de Sempé, que j’ai vu il y a quelques années dans un magazine. Le dessin représente une grande église gothique vue de l’intérieur, vide, avec, au pied de l’autel, une petite dame entre deux âges, tenant son sac serré contre sa poitrine. Elle est en train de prier, de parler au Bon Dieu. Et qu’est-ce qu’elle lui dit ? Ceci : « Mon Dieu, mon Dieu, j’ai tellement confiance en vous que, parfois, j’ai envie de vous appeler Docteur ! »
Dieu est mort : vive la Sécu ! Marx est mort : vivent les psychotropes ! Voilà ce que j’entends par pan-médicalisme. Et j’y vois bien sûr une illusion en même tempsqu’un danger. La médecine ne saurait tenir lieu ni de spiritualité ni de politique !
Bien formé, se débarrasse-t-on de sa responsabilité au prétexte que l’on fera mieux que le voisin ?
On ne se débarrasse jamais de sa responsabilité. Mais faire mieux que le voisin – surtout si c’est à coût identique – cela vaut mieux que faire moins bien.
Le paiement à l’acte est il forcément synonyme de conflit d’intérêts ?
« Forcément », non, sans doute pas. Mais votre question laisse entendre que le paiement à l’acte peut parfois mener au conflit d’intérêts, ce qui ne me semble guère contestable. Quand un dentiste me propose des soins très coûteux, parce que c’est mon intérêt, dit-il, il se trouve que c’est aussi, presque inévitablement, le sien. Mais alors, comment savoir ce qui détermine son avis ? Mon intérêt ou le sien ? Ce peut être les deux à la fois, et cela n’est pas choquant.
Mais il peut arriver que son intérêt, à ses yeux, l’emporte sur le mien ou influence la vision qu’il s’en fait… D’ailleurs, interrogez les dentistes : vous verrez que, lorsqu’ils parlent de leurs confrères, ils ne prétendent pas que le conflit d’intérêts est impossible ou toujours inexistant…
C’est pourquoi il est bon, parfois, de demander plusieurs avis différents. Cela vaut pour la médecine comme pour l’odontologie. L’idéal est d’avoir un ami médecin et un autre dentiste, qui ne vous soignent pas mais vous conseillent… Mais c’est une chance que tout le monde n’a pas.
Propos recueillis par Marc Roché,
président de la SOP
(1) « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». OMS, 1946.
* André Comte-Sponville est philosophe. Dernier ouvrage paru : « C’est chose tendre que la vie », édition Albin Michel, 2015.