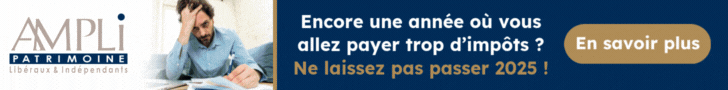Quel arbre décisionnel en prothèse amovible partielle ?
Quel arbre décisionnel en prothèse amovible partielle ?
Marc Roche
L’originalité de cette présentation réside dans la tentative de mise en place d’un arbre décisionnel en prothèse amovible partielle. Celui-ci synthétise la progression du diagnostic et du traitement dans une discipline où le recours à diverses spécialités de l’odontologie (chirurgie, parodontie, endodontie, dentisterie conservatrice, prothèse fixée) permet d’améliorer l’équilibre prothétique et l’intégration psychologique de la prothèse. Sous la forme pratique d’un arbre décisionnel, la visualisation de la complexité plus ou moins importante des traitements s’en trouve objectivée au travers de trajets schématiques.
Cas simples et cas complexes
Un cas simple peut se définir comme une situation clinique dans laquelle les interventions visant à préparer le site prothétique se résument aux coronoplasties axiales et occlusales, en fonction d’un tracé de châssis prédéfini et de l’analyse du modèle sur parallélomètre.
Un cas complexe nécessite la restauration préalable du cadre dans lequel sera insérée la future prothèse.
Cela peut sous-entendre :
• de redéfinir une position d’intercuspidie « minimale » après montage des modèles d’étude sur articulateur en relation centrée, en éliminant les interférences occlusales dans le trajet de fermeture et lors des excursions excentrées pour obtenir un calage à la DVO ;
d’étude sur articulateur en relation centrée, en éliminant les interférences occlusales dans le trajet de fermeture et lors des excursions excentrées pour obtenir un calage à la DVO ;
• de corriger, au moyen de cires de diagnostic, une courbe d’occlusion antagoniste par avulsion, prothèse fixe et/ou coronoplastie occlusale, voire ostéotomie segmentaire ;
• de procéder à la restauration prothétique des dents supports en fonction du rôle qui leur sera dévolu dans le traitement (morphologie découlant du tracé de châssis, du schéma occlusal et de l’axe d’insertion).
Une chronologie identique
Chaque problème et chaque obstacle à la réalisation d’une prothèse stable et équilibrée sont appréhendés selon une chronologie toujours identique. Elle commence par un tracé de châssis idéal qui subira des modifications en rapport avec les renseignements obtenus par l’analyse des modèles d’étude sur articulateur puis sur parallélomètre. Concernant l’égression de dents antagonistes d’édentement, le diagnostic différentiel devra être réalisé entre des égressions dentaires et dento-alvéolaires. Selon leur nature et leur degré, celles-ci pourront être résolues, du moins au plus invasif, par simple coronoplastie, coronoplastie et dévitalisation, prothèse fixée a minima associée à une élongation coronaire ou une avulsion.
 Résine, métal ou porcelaine ?
Résine, métal ou porcelaine ?
Enfin, lorsque l’espace prothétique reste minime, le choix de dents en résine ou des faces occlusales métalliques peut s’imposer par rapport aux dents en porcelaine (diatoriques) : modifications d’un projet de tracé de châssis pour se rapprocher du tracé définitif.
Lorsque le cadre occlusal dans lequel la prothèse doit s’insérer est restauré, et donc que les perturbations du plan d’occlusion sont résolues, la suite du traitement observe dans l’arbre décisionnel le traitement des cas où il y a absence d’égression. Il s’agira des modifications des formes de contours des dents supports de la prothèse amovible par coronoplasties :  axiales visant à faciliter l’insertion prothétique et le guidage des différents composants jusqu’à leurs positions fonctionnelles ; occlusales destinées aux logettes des appuis occlusaux. Lorsque ces coronoplasties deviennent plus importantes, l’indication de prothèse fixée peut s’imposer. Enfin, il peut être préféré à ce stade de modifier le tracé de châssis, en remplaçant par exemple le crochet d’Ackers n° 1 initialement choisi par un crochet à action postérieure si la ligne guide offre une rétention dans l’angle mésio-vestibulaire d’une deuxième molaire mandibulaire versée.
axiales visant à faciliter l’insertion prothétique et le guidage des différents composants jusqu’à leurs positions fonctionnelles ; occlusales destinées aux logettes des appuis occlusaux. Lorsque ces coronoplasties deviennent plus importantes, l’indication de prothèse fixée peut s’imposer. Enfin, il peut être préféré à ce stade de modifier le tracé de châssis, en remplaçant par exemple le crochet d’Ackers n° 1 initialement choisi par un crochet à action postérieure si la ligne guide offre une rétention dans l’angle mésio-vestibulaire d’une deuxième molaire mandibulaire versée.
Sommaire
- 9e Journées dentaires de l'île Maurice
- Page 1 : Surfaçage ou désinfection parodontale ?
- Page 2 : Plan de traitement en prothèse et parafonctions occlusales
- Page 3 : Les six clefs de la réussite prothétique
- Page 4 : En finir avec le stress du praticien
- Page 4 : Facettes de céramique collées: les 12 marches du "step by step"
- Page 5 : La collaboration dans un traitement implantaire: qui fait quoi ?
- Page 6 : Le défi de l'incisive centrale supérieure en implantologie
- Page 7 : Quel arbre décisionnel en prothèse amovible partielle ?
- Page 7 : Quatre questions pour décider d'un recouvrement radiculaire
- Page 8 : Comment préserver le volume osseux post-extractionnel ?
- Page 9 : Prothèse amovible totale: satisfaire aux doléances du patient
- Page 10 : La face cachée de l'orthodontie