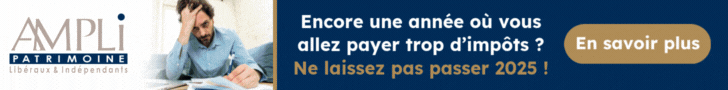Le traitement esthétique des dyschromies.

Le traitement esthétique des dyschromies
par René Serfaty

Les dyschromies dentaires peuvent être extrinsèques ou intrinsèques.
Les dyschromies extrinsèques sont causées par le dépôt de composés chromogènes sur la surface de l’émail et restent superficielles. Elles disparaissent avec un nettoyage prophylactique. Les dyschromies intrinsèques sont quant à elles attribuées soit à une modification de l’épaisseur des tissus durs de la dent, soit à l’incorporation de composés chromatiques dans l’émail et/ou la dentine. Elles peuvent survenir sur dents pulpées ou non et être accompagnées ou non d’anomalies structurelles des tissus durs dentaires, comme des porosités au niveau de l’émail.

De par l’impact social et donc la source de mal-être potentielle que les dyschromies dentaires peuvent induire, notre rôle de praticien est de pouvoir, dans la mesure du possible, y apporter des solutions esthétiques.
Une classification en trois groupes

Le traitement d’une dyschromie intrinsèque est fonction de l’étiologie. Cependant, diagnostiquer une dyschromie est difficile et, souvent, le doute persiste même pour les praticiens les plus aguerris. Les classifications proposées sont trop académiques ou trop complexes. Ainsi, nous proposons une classification thérapeutique en trois groupes, selon deux critères que sont l’importance de la dyschromie et l’absence ou la présence de porosités.
Groupe 1 : Dyschromies légères ou modérées sans porosités

Dans ce groupe, nous trouvons les tétracyclines légères stades 1 et 2, les fluoroses sans porosités de stade 1 ou 2, les opacités, l’amélogenèse imparfaite légère, la dent dépulpée, les déminéralisations postorthodontiques…
Groupe 2 : Dyschromies légères ou modérées avec porosités
Ce groupe est représenté par la fluorose de stade 2 et l’amélogenèse imparfaite avec porosités.

Groupe 3 : Dyschromies importantes avec ou sans porosités
Il comprend les tétracyclines de stade 4, la fluorose de stade 3, la dentinogenèse imparfaite, la dent de Turner présentant des porosités ainsi que certaines formes sévères d’amélogenèse imparfaite.
Solutions thérapeutiques

Un e suite logique et surtout progressive de traitements est proposée, allant d’une solution simple comme l’éclaircissement jusqu’aux solutions plus complexes telles que la facette en composite ou en céramique. Ainsi, pour le traitement du groupe 1, nous débuterons par un éclaircissement qui va atténuer la dyschromie, puis nous tenterons une micro-abrasion et, si le résultat reste insuffisant, nous éliminerons le tissu coloré a minima à l’aide d’inserts à ultrasons diamantés afin d’y coller un composite de masse émail. Le groupe 2 sera traité prioritairement par micro-abrasion afin de réduire les porosités puis, éventuellement, par macro-abrasion. Une infiltration résineuse pourra être utilisée dans les groupes 1 et 2 si les taches sont blanches, opaques, mais le résultat reste incertain. Le groupe 3 sera traité prioritairement par un éclaircissement avant d’utiliser des composites ou des facettes.
La combinaison de ces différentes techniques est souvent nécessaire pour obtenir un résultat esthétique fiable, pérenne et économe en tissu.
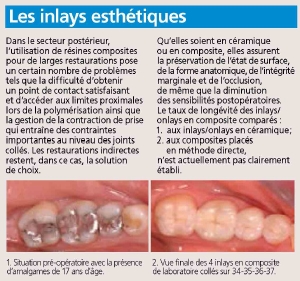

Légendes des 6 photographies :
photo 1 : Fluorose de stade 2 sans porosités sur 11 et 21.
photo 2 : Atténuation des dyschromies après éclaircissement.
photo 3 : Réalisation de micro-abrasion.
photo 4 : Résultat après micro-abrasion.
photo 5 : Résultat après élimination a minima des dyschromies.
photo 6 : Collage d’un composite de masse émail de luminosité équivalente à celle de l’émail.
Sommaire
- 12e journées de chirurgie dentaire à l'île Maurice
- Page 1 : Comprendre l'usure des dents.
- Page 2 : Agénésie des incisives latérales, que faire ?
- Page 3 : Utilisation du tissu conjonctif en chirurgie plastique parodontale et péri implantaire.
- Page 4 : Le traitement esthétique des dyschromies.
- Page 5 : Atteintes des tissus péri-implantaires : prévenir, diagnostiquer, traiter.
- Page 6 : Les implants courts et les implants étroits.
- Page 7 : Le tracé de châssis en PAP.
- Page 8 : La couronne provisoire, temporaire ou transitoire.
- Page 9 : Deux séances de TP pour les confrères mauriciens.